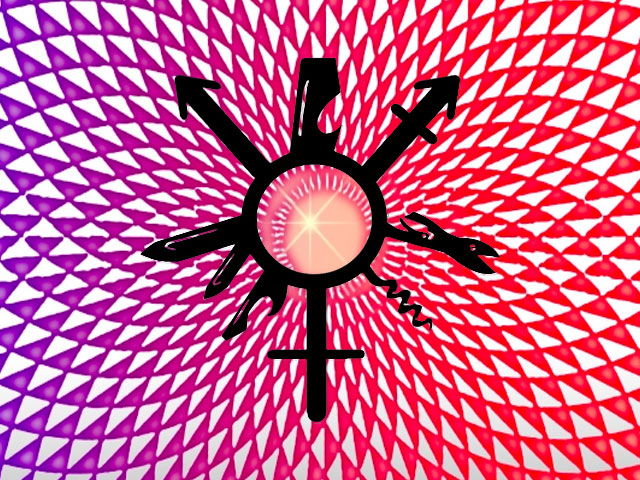Depuis le mois de juin, l’Australie offre la possibilité de choisir le sexe indiqué sur les documents officiels : homme, femme ou transgenre. L’Allemagne est le premier pays européen à reconnaître officiellement l’existence d’un troisième genre en permettant d’inscrire « sexe indéterminé » sur les certificats de naissance des nouveau-nés depuis le 1er novembre. En Suède, le pronom neutre « hen » (pour remplacer les il [han, en suédois] et elle [hon]) a fait son entrée dans l’Encyclopédie nationale suédoise. Les conceptions des genres évoluent, s’ouvrent… et dérangent. Pourquoi ?
Par genre, on entend toute « construction sociale qu’on érige dans les différentes sociétés sur la base de la donnée biologique du sexe. » Quelques exemples ? Les femmes sont sensibles, les hommes se laissent moins atteindre par leurs émotions. Les femmes sont plus bavardes que les hommes. Les femmes connaissent l’instinct maternel. Malheureusement, la liste est longue, très longue. La théorie du genre connaît son essor depuis les années nonante, notamment grâce à la philosophe américaine Judith Butler, auteure de « Trouble dans le genre, pour un féminisme de la subversion » (1990) et « Défaire le genre » (2004). Dans ces ouvrages, Butler soutient que le genre est performatif, et qu’il n’y a pas une identité derrière la manière les actes, les comportements censés exprimer le genre, mais plutôt l’illusion d’une identité de genre stable (homme ou femme). Le genre n’est donc pas quelque chose d’établi : il peut être mis à mal et évoluer. Il est fluide.
Mais cette théorie est loin de plaire à tout le monde. Ces dernières semaines, les voix de ses détracteurs se sont fait entendre à plusieurs reprises, notamment au sein d’une conférence qui a eu lieu le 18 novembre. Parmi les orateurs se trouvait Maria Hildigsson, secrétaire générale de la Fafce (fédération des associations de familles catholiques en Europe), qui parle d’ « écologie humaine » pour désigner ce qu’elle considère comme les lois naturelles de la famille (nous préférons quant à nous le terme d’hétéronormativité !) : « la famille fondée sur le mariage s’inscrit dans une complémentarité entre l’homme et la femme. Quelles que soient les prouesses de la technique, un enfant va toujours naître de l’union des corps de l’homme et de la femme. Sans ces deux composants, il n’y aura pas d’enfant. Donc, le milieu naturel de l’enfant est très généralement d’être élevé par son père et par sa mère, même si on connaît bien certaines conditions familiales qui diffèrent (Cela a toujours existé : veuvage, etc.). L’enfant a besoin de ce terreau qui est le sien. » (1)
Même blabla conservateur dans une carte blanche publiée récemment dans la Libre Belgique : « On oublie que l’hétérosexualité n’est pas un comportement parmi d’autres, mais bien l’expression d’une rencontre dans la différence des sexes, qui seule ouvrira un jour à la vie et à l’enfant. Une dimension humaine exceptionnelle, celle qui crée la famille humaine, qui ne peut pas être occultée sans manquer gravement à ce que nous devons aux générations qui viennent après nous. » (2)
On reconnaît sans peine le vocabulaire et le ton des opposants au mariage pour tous en France. Les arguments aussi sont aussi les mêmes, et se résument à cette idée unique : un enfant naît d’un homme et d’une femme.
« Les hommes sont poussés à conquérir le monde tandis que les filles sont poussées à conquérir… un homme »
Mais pourquoi cette obsession pour le modèle de famille mononucléaire et hétérosexuelle ? Première réponse évidente (et rabâchée par les défenseurs de ce modèle) : la reproduction. Un homme + une femme = un enfant. Et faire des enfants est nécessaire à la société capitaliste : il s’agit de reproduire la force de travail. On ne s’étonnera pas que ceux que le genre dérange luttent aussi contre la contraception et le droit à l’avortement. Or tout cela fait partie des droits de la femme à disposer librement de son corps et de sa sexualité. Autre justification du modèle familial occidental : c’est à travers les enfants et la succession que se transmettent les richesses. Cela explique l’importance accordée à la fidélité dans notre société, et tout particulièrement à celle des femmes : il s’agit de garantir la patrilinéarité de la succession. Les distinctions de genre stéréotypées (homme ou femme) contribuent à caser les personnes dans leur rôle spécifique dans la société et dans l’économie. Comme l’explique Nadia De Mond, (3) « les hommes sont poussés à conquérir le monde tandis que les filles sont poussées à conquérir… un homme. Cela imprègne notre manière de penser : on doit se marier, devenir mère, etc. et cela jusqu’à aujourd’hui. Là-dedans, il n’y a pas de place pour une orientation sexuelle différente. Cette construction fait partie de l’idéologie dominante donc elle n’est pas seulement présente dans la famille, elle l’est aussi dans toutes les images qui nous entourent et forment notre imaginaire du possible, de ce que l’on peut atteindre et nous permettent de nous forger une image de ce que l’on peut devenir en tant qu’adulte réalisé. Cette identité de genre est assimilée par les deux sexes. L’infériorité des femmes est intériorisée par les femmes elles-mêmes, ce qui est bien sûr un obstacle à leur libération à la solidarité entre elles. Dans notre société, le mâle constitue la norme. La femme, le produit dérivé. »
En tant que féministes, nous devons lutter contre tout ce qui justifie les inégalités entre les hommes et les femmes et qui pousse à nous diviser : tant les stéréotypes de genres que les discriminations liées à l’orientation sexuelle. Les luttes féministes et LGBTI sont étroitement liées et les combats à mener sont nombreux, dans un contexte de crise qui voit s’élargir les mouvements des conservateurs de tout poil (« pro-vie », « manif pour tous », « anti-genre », etc.).