À propos de Jérôme Baschet, Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, Paris, La Découverte, 2014, 160 p., 15€. [Réédition en 2016, 208 p., 8,5€.]
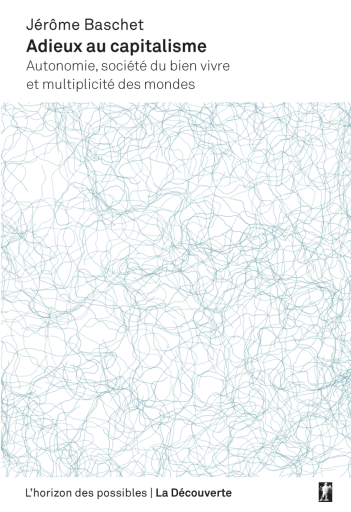
Le titre de l’ouvrage de Jérôme Baschet – Adieux au capitalisme –, plonge directement le curieux dans un univers à la fois explicite et ouvert. Dans cet essai, il est d’emblée question d’un projet politique tournant le dos à la société marchande d’accumulation du capital. Dans un geste anticapitaliste assumé, l’historien français spécialiste du mouvement zapatiste pose donc une balise politique relativement claire. Pour autant, le choix du pluriel – adieux – annonce la complexification des schémas stratégiques que Baschet appelle de ses vœux. L’anticapitalisme est la porte d’entrée par laquelle il nous invite à passer pour pénétrer dans un monde aussi vaste qu’ouvert : celui du champ des possibles d’une société émancipée.
Car l’essai ambitionne avant toute chose de vivifier l’action anticapitaliste. Baschet appelle dans ce travail à l’élargissement des considérations politiques et stratégiques, préalable nécessaire à la refondation d’un projet émancipateur ambitieux, que d’aucuns appelleraient un socialisme du XXIe siècle.
Les quatre sources d’inspiration de l’anticapitalisme
L’essai de l’historien prend appui sur un objectif : relancer le désir d’une société autre, réinsuffler l’inspiration utopique, comme préalable à la mise en mouvement des femmes et des hommes vers la transformation sociale. Cet objectif aussi nécessaire qu’ambitieux émerge d’un constat simple : le système capitaliste et étatique tient moins par l’adhésion volontaire de l’humanité que par un mélange de résignation passive et de dépendance matérielle – réelle ou supposée – à celui-ci (p. 8). Le système repose sur une forme d’inertie conservatrice qui ne demande qu’à être bousculée ; « étrange tautologie » qui fait, comme le dit Baschet lui-même, que « cela tient parce que cela tient. C’est à dire aussi… jusqu’au moment où ça commence à ne plus tenir » (p. 154). La voie de sortie de cette tautologie, et la mise en échec de la plasticité du système, passent selon Jérôme Baschet par quatre clés complémentaires.
D’abord bien sûr, le refus de l’oppression capitaliste, le geste de révolte contre les injustices de l’ordre établi. Mais le travail de Baschet à ceci de particulier qu’il décentre cette révolte, en la déclassant au statut d’ingrédient parmi d’autres, tout aussi indispensables. S’il prend la peine de déconstruire les solutions néo-keynésiennes pour préférer les options révolutionnaires (chapitre 1), il ne cherche d’ailleurs pas à détailler les tenants et aboutissants de ce geste premier.
La seconde source prend la forme de l’utopie positive, c’est-à-dire de la constitution d’expériences concrètes, le plus en marges possibles du système, et qui donnent à voir – même de manière partielle et inaboutie – l’existence d’un au-delà du capitalisme. C’est ce que Baschet nomme les « espaces libérés » (p. 157) du double fétichisme de la marchandise et de l’État – les deux maîtres de l’esclavage moderne selon l’auteur. Nous pourrions disserter sur leur capacité à être réellement libérés ou non du système. Mais ce qui importe chez Baschet, c’est surtout le statut de l’expérience comme témoignage, la lueur d’espoir qui permet de rester debout dans le brouillard de l’oppression. C’est là la grande affirmation qui sous tend cet essai : plus que d’un cap, le combat collectif anticapitaliste a besoin d’un carburant pour faire tourner son moteur à plein ; et ce carburant, ce sont les expériences positives, la construction même partielle d’alternatives qui offrent la croyance et l’espoir nécessaires à la mise en mouvement des sujets individuels et collectifs. La forme centrale de cette alternative, c’est l’autogouvernement, la constitution de formes démocratiques radicales et collectivement appropriées depuis la base de la société (production, habitation) dont Baschet nous donne quelques célèbres exemples : la Commune de Paris, les conseils ouvriers, et plus récemment le mouvement zapatiste – nous allons y revenir. Pour rares qu’ils soient, ces espaces libérés n’en demeurent pas moins précieux et ne sont pas, pour l’auteur, totalement détachés du quotidien capitaliste. En optimiste, il essaie de trouver dans l’environnement dominant quelques unes des bases matérielles capables de préfigurer certains aspects de la société à construire. Parmi celles-ci, Baschet s’arrête longuement sur la question du partage du travail. Dans le sillage des récents travaux de Pierre Larrouturou et Dominique Méda1, il projette une diminution massive du temps de travail, permise par un double mouvement de disparition des fonctions inutiles ou nuisibles (socialement et écologiquement) et de partage du travail nécessaire. Un tel virage, préfiguré par le chômage structurel de nos sociétés, engendrerait une révolution du temps que Jérôme Baschet appelle de ses vœux : l’entrée dans ne société du temps disponible au sein de laquelle les individus répartiraient leur temps « utile » entre production de biens et services, et participation active à la vie de la cité.
Préfigurer les devenirs utopiques de la société donc, mais aussi reconsidérer les espaces déjà existants et restés imperméables à la logique marchande : c’est le troisième ingrédient de stimulation anticapitaliste livré par Jérôme Baschet. Sur ce point spécifique transparait sa sensibilité pour la question indigène en général, et pour le mouvement zapatiste en particulier – bien que celui-ci soit très loin de se réduire à sa dimension indigène. Baschet invite en effet l’anticapitalisme occidental à se décentrer pour considérer l’inspiration alternative que représentent les sociétés parvenant à se maintenir, au moins partiellement, à la marge du marché capitaliste – malgré l’effort de ce dernier pour grignoter des espaces croissants à travers le monde2. Il présente ainsi un contre-modèle de société du bien vivre tel que proposé par certains peuples amérindiens, reposant selon lui sur une éthique du collectif et de l’équilibre dans les relations entre les êtres. Ajouté aux deux précédents, cet ingrédient permet à Baschet d’envisager un anticapitalisme « par les deux bouts » (p. 130) : celui de ceux qui s’efforcent à sortir de la logique marchande et celui de ceux qui résistent à y entrer en défendant et créant des formes de vie, généralement collectives et communautaires (p. 126), qui échappent à la société capitaliste. L’existence de ces deux bouts témoigne de la nécessité d’une dimension anthropologique de la révolution (chapitre 4). Décentrer la logique anticapitaliste de l’universalisme abstrait occidental implique pour Baschet de se défaire de trois dimensions ontologiques intimement liées au système capitaliste dominant (p. 145) : l’idée d’une nature présociale de l’individu, celle d’une prééminence de l’individu sur la société, et enfin la distinction entre nature et culture3.
Le quatrième et dernier ingrédient apporté par l’auteur est la nécessité d’un bilan critique des expériences et tentatives révolutionnaires passées. Sans s’appesantir sur la question, Baschet identifie au fil de son essai plusieurs écueils dévastateurs qu’il appelle donc à mettre à distance pour éviter d’avoir à jeter le bébé avec l’eau du bain. Face à la surévaluation de l’Etat comme instance de régulation sociale, Baschet prône l’autonomie et la célébration de la pluralité des formes de la reconstruction post-capitaliste. Contre l’attentisme provoqué par une foi excessive dans des lois sociales déterministes qui porteraient la chute du capitalisme, il défend donc l’activisme alternatif et créatif des espaces libérés. Contre une temporalité révolutionnaire sclérosée (par l’attente messianique d’un grand soir ou le cloisonnement rigide entre le temps de la destruction révolutionnaire, et celui de la reconstruction sociale), il prône une historicité plurielle assumant un « détour par le passé » pour envisager les constructions du futur (p. 129). Au prix de quelques apories, Jérôme Baschet travaille ainsi à la consolidation d’un courant anticapitaliste solidifié et englobant. Si l’appel à la diversification est convaincant, de nombreuses questions restent évidemment en suspend. Parmi elles, celle du dépassement (ou de la convergence) des luttes fractionnées et isolées reste doublement urgente : pour que la destinée des espaces libérés ne se résume pas au choix entre évanouissement ou ingestion par le système capitaliste ; et pour que l’accumulation de ces expériences ne serve pas qu’à garnir les albums photos, mais travaille effectivement à fissurer la société de la marchandise.
L’autogouvernement zapatiste en étendard
Là où le travail d’exploration de Baschet est le plus convaincant, c’est lorsqu’il aborde le mouvement qu’il côtoie depuis plusieurs années : l’autogouvernement zapatiste.
L’ouvrage a le mérite d’éclairer le statut réservé à cette expérience. Comme Baschet s’est toujours évertué à le rappeler, reprenant sur ce point le discours des zapatistes eux-mêmes, il ne s’agit aucunement de faire de cette expérience un modèle à dupliquer. Toute proportion gardée, Baschet donne à l’expérience zapatiste aujourd’hui le statut que Marx donnait à la Commune de Paris au crépuscule du XIXe siècle, lorsqu’il évoquait « la forme politique enfin trouvée » de l’émancipation sociale4, qui n’existait jusqu’alors que sous la forme d’élaboration théorique. Si le parallèle se retrouve jusque dans la formule5, c’est la dimension inspirante de ces expériences qui permet surtout de les rapprocher. Après avoir marqué dans ses chairs une génération de militants, les analyses de Marx et Bakounine sur la Commune ont contribué à faire de cette expérience la matrice des expériences révolutionnaires les plus abouties du début du XXesiècle, que furent les soviets et les conseils6.
Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que le mouvement zapatiste aura la même influence sur les mouvements révolutionnaires à venir. Baschet invite malgré tout à s’inspirer de ce qui constitue sans doute l’expérience d’autogouvernement la plus aboutie de ces dernières décennies. Dans son exploration des sources d’inspiration utopiques de l’anticapitalisme, le zapatisme apparaît donc comme l’argument le plus convaincant et le plus riche. Comme la Commune en un autre temps, Baschet rappelle que le plus grand intérêt du mouvement zapatiste est son existence même, lorsqu’il cite les paroles d’Eloisa, cette maestra de l’école zapatiste : « Ils ont peur que nous découvrions que nous sommes capables de nous gouverner nous-mêmes »7. Tout est dit ?
Ces paroles résument en tout cas l’intérêt essentiel que revêt l’étude de l’autogouvernement zapatiste, sur lequel Jérôme Baschet revient dans le chapitre 2 de son essai. Dans son combat pour l’autonomie d’abord, le mouvement zapatiste rappelle que l’institution de pratiques politiques radicalement démocratiques ne se fait pas par magie. Il existe bien des conditions sociales à l’autogouvernement, qui sont, entre autres, l’appropriation des ressources (appropriation des terres et des villages, à la fois espaces de vie et lieu de production et de travail) et l’instauration d’une forme d’égalité sociale (partage et redistribution des surplus de production, encadrement des règles de rétribution des postes publics).
Dans sa pratique démocratique ensuite, la politique zapatiste met en œuvre des principes qui vont à rebours de la spécialisation actuelle des tâches et du fonctionnement vertical de nos régimes politiques comme de notre monde social. Fonctionnant selon un principe de subsidiarité en cercles concentriques, la politique zapatiste fait de la commune son épicentre, avant de ne déléguer aux niveaux supérieurs que les tâches qui nécessitent coordination. Les délégués sont contrôlés et révocables en permanence. La distribution des charges politiques fonctionne sur un principe rotatif rapide (quelques semaines), permettant au plus grand nombre d’exercer alternativement les positions de gouvernés et gouvernants, et ainsi de réduire au maximum l’écart entre ces deux fonctions. La politique comme sphère spécialisée tend à disparaître pour être réintégrée aux autres fonctions sociales. Comme le rappelait Daniel Bensaïd pour la Commune de Paris8, cela ne signifie ni la suppression de la politique comme sphère d’arbitrage, ni celle de la délégation/représentation, mais plutôt la ré-articulation de l’horizontalité et de la verticalité. Baschet l’interprète bien en ce sens : la lenteur de ce fonctionnement est assumée et intégrée dans une logique du tâtonnement et de l’apprentissage par la pratique, qui tend à bouleverser radicalement le rapport entre théorie et pratique, comme celui qui distingue traditionnellement les tâches de direction et d’exécution.
Au-delà des principes mis en place, l’autogouvernement intéresse également Jérôme Baschet pour sa stratégie, alimentant ainsi le travail de bilan des expériences révolutionnaires qu’il appelle de ses vœux. L’histoire du mouvement rappelle que la distinction stricte entre une phase révolutionnaire destructrice et une phase constructrice n’a rien d’une évidence ni d’une nécessité, et que celles-ci peuvent très bien s’imbriquer d’une manière nouvelle et originale. L’abandon de l’obsession centraliste est également notable d’un point de vue organisationnel9, mais aussi politique, puisque les zapatistes ont explicitement fait le choix de se détourner du pouvoir étatique, pour construire l’autogouvernement depuis les communautés à la base de son édifice.
Le geste de libération de l’imaginaire anticapitaliste s’exprime à merveille dans l’expérience zapatiste, malgré toutes les limites de cette dernière10. Les quatre ingrédients de vivification de l’anticapitalisme appelés par Baschet se conjuguent dans cette expérience : Née de l’exaspération et de la révolte (Ya Basta !), elle propose l’expérimentation positive d’un espace libéré (l’autogouvernement), prend appui sur des traditions indigènes restées à l’écart du marché capitaliste (forme collective du travail de la terre), et son existence même questionne le bilan des expériences révolutionnaires passées (question de l’État et de l’organisation). L’élaboration du combat anticapitaliste ne peut en ressortir qu’enrichie.
références :
| 1. | ⇧ | Pierre Larrouturou et Dominique Méda, Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail, Paris, éd. de l’Atelier, 2016. |
| 2. | ⇧ | Voir le travail de David Harvey sur l’ « accumulation par dépossession » auquel Baschet fait également référence : David Harvey, Géographie de la domination, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2008. [À propos de cette notion, voir sur notre site l’article de Jean Batou, « Accumulation par dépossession et luttes anticapitalistes : une perspective historique longue » – NDLR]. |
| 3. | ⇧ | Voir Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. |
| 4. | ⇧ | Karl Marx, La guerre civile en France (1871), Montreuil-sous-Bois, éd. Science marxiste, p. 73. |
| 5. | ⇧ | « L’autogouvernement est la forme trouvée de la démocratie radicale » (ibid., p. 72). |
| 6. | ⇧ | Les travaux de Lénine, Luxemburg, Pannekoek ou Trotsky prennent tous appui, à un moment ou un autre, sur l’expérience de la Commune de Paris. |
| 7. | ⇧ | Citée par Jérôme Baschet, p. 70. |
| 8. | ⇧ | Daniel Bensaïd, « Politiques de Marx » in K. Marx, F. Engels, Inventer l’inconnu : textes et correspondance autour de la Commune, Paris, La Fabrique, 2008. |
| 9. | ⇧ | Il faudrait détailler ici l’évolution du rôle de l’EZLN, organisation militaire à l’origine de l’insurrection de 1994 et bras armé de l’autogouvernement civil zapatiste. Nous renvoyons pour cette question au travail de Carlos Tello-Díaz, La rebelión de las cañadas: origen y ascenso del EZLN, México, Booket, 2006. |
| 10. | ⇧ | Au premier rang desquelles le fait de n’avoir pas réussi à faire chuter le gouvernement mexicain. |
Source : contretemps











